https://lesbelleslettresblog.com/2020/10/07/isaiah-berlin-detaille-lintuition-profonde-de-leon-tolstoi-lecteur-de-joseph-de-maistre
Éditions Les Belles Lettres : le blog
Éditions Les Belles Lettres : le blog
Isaiah Berlin détaille l’intuition profonde de Léon Tolstoï, lecteur de Joseph de Maistre
LA CHOUETTE 7 OCTOBRE 2020

Dans son célèbre essai sur la vision de l’Histoire de Tolstoï, Le Hérisson et le Renard, que nous republions augmenté d’une préface de Mario Vargas Llosa, le grand historien des idées Isaiah Berlin développe les similitudes profondes entre le Savoyard « Voltaire de la réaction », et le Russe « renard, qui se croyait hérisson ». Extraits.
« Le renard sait beaucoup de choses, mais le hérisson sait une grande chose. »
Cet aphorisme du grec ancien, qui fait partie des fragments du poète Archiloque, décrit la thèse centrale de l’essai magistral d’Isaiah Berlin sur Léon Tolstoï et la philosophie de l’histoire, sujet de l’épilogue de Guerre et Paix.
Bien qu’il y ait eu de nombreuses interprétations de cet adage, Berlin s’en sert pour opérer une distinction fondamentale entre les êtres humains fascinés par l’infinie variété des choses et ceux qui relient tout à un système central et englobant.
Appliqué à la pensée de Tolstoï, ce propos éclaire un paradoxe qui nous aide à expliquer sa philosophie de l’histoire : le romancier russe était un renard alors qu’il croyait être un hérisson. Cet extraordinaire essai, traduit par la femme du philosophe, est une des œuvres les plus célèbres de Berlin. Elle permet une compréhension en profondeur de Tolstoï, de la pensée historique et de la psychologie humaine.
Prochainement paraîtra aux éditions Gallimard le nouvel essai de Mario Vargas Llosa, L’Appel de la tribu. Entre autres hommages aux penseurs qui ont marqué l’écrivain, il contiendra un portrait d’Isaiah Berlin (1909-1997) reproduit dès à présent en préface de notre édition. En voici un extrait :
Les vérités contradictoires
Croire qu’il existe une seule réponse véritable à chaque problème humain et qu’une fois trouvée cette réponse, toutes les autres doivent être rejetées comme erronées est une constante de la pensée occidentale.
Corollairement, on a toujours cru que les idéaux les plus nobles qui animent les hommes – justice, liberté, paix, plaisir, etc… − étaient compatibles entre eux. Pour Isaiah Berlin, ces croyances sont fausses et de là viennent en grande partie les tragédies de l’humanité. Il tire de ce scepticisme des arguments puissants et originaux en faveur de la liberté de choix et du pluralisme idéologique.
Fidèle à sa méthode indirecte, Isaiah Berlin expose sa théorie des vérités contradictoires ou des fins irréconciliables à travers d’autres penseurs chez qui il trouve des indices et des anticipations de cette thèse. (…)
Toutes les utopies sociales – de Platon à Marx – sont parties d’un acte de foi : à savoir que les idéaux humains, les grandes aspirations de l’individu et de la collectivité, sont capables de s’harmoniser, et que la satisfaction de l’un ou de plusieurs de ces buts n’est pas non plus un obstacle pour la matérialisation des autres. Rien, peut-être, n’exprime mieux cet optimisme que le slogan rythmique de la Révolution française : Liberté, Égalité, Fraternité. Ce généreux mouvement qui a prétendu établir le gouvernement de la raison sur terre et matérialiser ces idéaux simples et indiscutables a démontré au monde, à travers ses boucheries répétées et ses multiples frustrations, que la réalité sociale était plus tumultueuse et imprévisible que ne le supposaient les abstractions des philosophes qui avaient prescrit des recettes pour le bonheur des hommes. La démonstration la plus inattendue – que beaucoup aujourd’hui refusent encore d’accepter – c’est que ces idéaux se repoussaient l’un l’autre dès l’instant même où ils passaient de la théorie à la pratique ; et qu’au lieu de se conforter entre eux, ils s’excluaient. Les révolutionnaires français ont découvert, stupéfaits, que la liberté était une source d’inégalités et qu’un pays où les citoyens jouiraient d’une capacité totale ou très large d’initiative, et du gouvernement de leurs actes et de leurs biens, serait tôt ou tard un pays scindé par de nombreuses différences matérielles et spirituelles. Ainsi, pour établir l’égalité, il n’y aurait d’autre remède que de sacrifier la liberté, d’imposer la contrainte, la surveillance et l’action toute-puissante et niveleuse de l’État. Que l’injustice sociale soit le prix de la liberté et la dictature celui de l’égalité – et que la fraternité ne puisse s’instaurer que de façon relative et transitoire, pour des causes plus négatives que positives, comme dans le cas d’une guerre ou d’un cataclysme qui regrouperait la population en un mouvement solidaire – est quelque chose de regrettable et difficile à accepter.
Cependant, d’après Isaiah Berlin, ce qui est plus grave que d’accepter ce terrible dilemme du destin humain c’est de refuser de l’accepter (faire l’autruche). Par ailleurs, pour tragique qu’elle soit, cette réalité permet de tirer des leçons profitables en termes pratiques.
Les philosophes, historiens et penseurs politiques qui ont perçu intuitivement ce conflit – celui des vérités contradictoires – ont montré une aptitude plus grande à comprendre le processus de la civilisation. (…)
Comme Herzen, Berlin rappelle souvent les preuves historiques selon lesquelles il n’y a pas de justice qui aurait résulté d’une politique injuste ou de liberté qui soit née de l’oppression. Ils croient tous deux, pour cette raison, qu’en matière sociale il faut toujours préférer les succès partiels mais efficaces aux grandes solutions totalisatrices, fatalement chimériques.
(Pages 20-24. Traduit de l’espagnol par Albert Bensoussan et Daniel Lefort )
« Pour ce qui est de la valeur attachée aux idées par les historiens de la culture, chacun sait que les hommes ont tendance à exagérer l’importance de leurs propres denrées : les idées sont le produit de base des intellectuels, comme le cuir pour le savetier, et les professeurs tendent simplement à exagérer leurs activités personnelles jusqu’à en faire la « force » principale qui gouverne le monde. » Isaiah Berlin, page 83
Nous vous proposons à présent de découvrir quelques pages brillantes où Berlin, penseur discret et habile, déploie sa thèse désormais célèbre. Dans une large dernière partie, de surcroît, Isaiah Berlin éclaire également pour nous l’influence majeure qu’a eue Joseph de Maistre sur Léon Tolstoï, influence méconnue et pourtant déterminante. Extraits.
Il ne s’agit pas d’une conception mystique ou intuitionniste de la vie. Notre ignorance de la façon dont les choses se passent n’est pas due au fait que les causes premières sont, au départ, inaccessibles, mais seulement à leur multiplicité, à la petitesse des unités ultimes, et à notre propre incapacité de voir, d’entendre, de nous souvenir, d’enregistrer et de coordonner une quantité suffisante du matériel disponible. Théoriquement, l’omniscience est possible même pour des êtres empiriques, mais en pratique elle est évidemment irréalisable. C’est cela seul, et rien d’autre de plus profond ou de plus intéressant, qui est la source de la mégalomanie humaine, de toutes nos absurdes illusions. Étant donné qu’en fait nous ne sommes pas libres, mais ne pourrions pas vivre sans la conviction de l’être, que devons-nous faire ? (page 92)
Comme tout analyste doué d’une profonde pénétration, d’une grande imagination et d’une vision claire, qui dissèque ou pulvérise afin d’atteindre le noyau indestructible, et justifie son activité annihilante (dont il est incapable de s’abstenir en tout cas) par la conviction que ce noyau existe – Tolstoï continua à détruire les constructions bancales de ses rivaux avec un froid mépris, comme indignes d’hommes intelligents. Il le faisait dans l’espoir perpétuel que cette unité « réelle », si ardemment recherchée, émergerait bientôt après la destruction des imposteurs et des charlatans de cet ensemble de philosophies de l’Histoire des XVIIIe et XIXe siècles. Et plus il soupçonnait que sa recherche était vaine, que ni noyau ni principe unificateur ne seraient jamais découverts, plus devenaient féroces ses moyens pour chasser cette idée, en détruisant de plus en plus impitoyablement et ingénieusement les faux détenteurs de la vérité. Plus Tolstoï s’éloignait de la littérature pour se diriger vers la polémique, plus cette tendance s’accentuait : la conviction irritante, au fond de sa pensée, qu’aucune solution finale n’était, en principe, trouvable l’amena à attaquer d’autant plus violemment les solutions fausses, le pseudo-confort qu’elles offraient, parce qu’elles étaient une insulte à l’intelligence. Le génie purement intellectuel de Tolstoï pour ce genre d’activité destructrice était exceptionnel, et toute sa vie il chercha quelque édifice suffisamment fort pour résister à ses propres engins de destruction, à ses mines, à ses béliers ; il espérait rencontrer un obstacle immuable, et des fortifications imprenables qui puissent résister à ses violents projectiles. (Pages 99-100)
Cette contradiction violente entre les données de l’expérience dont il ne pouvait pas se libérer et qui, bien entendu, étaient pour lui les seules vraies, et sa foi profondément métaphysique en l’existence d’un système auquel elles doivent appartenir – qu’elles en aient l’air ou non – ce conflit entre son jugement instinctif et sa théorie, entre ses dons et ses opinions, reflète le conflit non résolu entre la réalité de la vie morale d’une part – sens de la responsabilité, joies, chagrins, sentiment de culpabilité et de réussite – qui est néanmoins une illusion et, d’autre part, les lois qui gouvernent tout, qui seules sont réelles, mais comme nous ne pouvons en connaître qu’une fraction négligeable, tous les hommes de science et les historiens qui prétendent les connaître et être guidés par elles mentent et nous trompent. (Page 105)
Le 1er novembre 1865, époque où il écrivait Guerre et Paix, Tolstoï nota dans son journal : « Je lis Maistre » ; et le 7 décembre 1864, il écrivait à l’éditeur Barteniev, qui lui servait en quelque sorte de collaborateur, pour lui demander de lui envoyer « les archives Maistre », c’est-à-dire ses lettres et ses notes. Rien d’étonnant à ce que Tolstoï ait lu cet auteur aujourd’hui relativement peu connu. Le comte Joseph de Maistre était un Savoyard royaliste, qui s’était d’abord fait une renommée en écrivant des tracts antirévolutionnaires pendant les dernières années du XVIIIe siècle. Bien qu’il soit normalement classé comme écrivain catholique réactionnaire, pilier de la Restauration et défenseur du statu quo prérévolutionnaire, en particulier de l’autorité papale, il fut bien plus que cela. Il soutint farouchement des opinions anticonventionnelles et misanthropiques sur la nature des hommes et de la société. Il écrivit avec une violence caustique et ironique sur la nature incurablement sauvage et mauvaise de l’homme, sur e caractère inévitable du carnage perpétuel, sur le caractère divinement institué des guerres et le rôle écrasant que joue dans les affaires humaines la passion pour le sacrifice qui, plus que le sens social naturel ou les accords artificiels, crée les armées et les sociétés civiles.
Il insistait sur la nécessité de l’autorité absolue, des châtiments et de la répression continuelle, sans lesquels la civilisation et l’ordre ne peuvent survivre. Aussi bien le contenu que le style se rapprochent davantage de Nietzsche, de D’Annunzio et des précurseurs du fascisme moderne que des royalistes respectables de son temps ; cela causa de l’émoi, à l’époque, tant chez les légitimistes que dans la France napoléonienne. (…)
Tolstoï possédait les Soirées, ainsi que la Correspondance diplomatique et les Lettres de Maistre ; on en trouva des exemplaires dans sa bibliothèque à Iasnaïa Poliana. Il est en tout cas certain que Tolstoï les utilisa abondamment dans Guerre et Paix. (…)
Ces ressemblances et ces parallèles ont été soigneusement collationnés par les érudits tolstoïens, et ne laissent aucun doute sur l’étendue du matériel emprunté par Tolstoï. (…)
Certaines de ces similitudes ont une plus grande importance. Maistre explique que la victoire légendaire des Horaces sur les Curiaces – comme d’ailleurs toutes les victoires – était due à ce facteur intangible, le moral ; et Tolstoï parle de même de la suprême importance de cet élément inconnu – de cet insaisissable « esprit » des troupes et de leurs chefs – qui détermine le résultat des batailles. Cette insistance sur l’impondérable est le caractère essentiel de tout l’irrationalisme de Maistre. Plus clairement et plus courageusement que quiconque avant lui, Maistre déclarait que l’intelligence humaine n’est qu’un faible instrument face à la puissance des forces naturelles, et que des explications rationnelles de la conduite humaine expliquent rarement quelque chose.
Il soutenait que seul ce qui est irrationnel, justement parce qu’il s’agit d’un défi à toute explication et ne peut donc être sapé par les activités critiques de la raison, est capable de persister et de rester fort. Il donna comme exemple des institutions aussi irrationnelles que la monarchie héréditaire et le mariage, qui ont survécu d’âge en âge, tandis que des institutions rationnelles comme la monarchie élective, ou les rapports « libres » entre les hommes, se sont effondrées rapidement et sans « raison » apparente, partout où elles furent introduites.
Maistre concevait la vie comme une bataille féroce à tous les niveaux, entre plantes et animaux autant qu’entre individus et nations, sans aucun profit, mais née d’un certain appétit insatiable, primitif, mystérieux, sanguinaire et auto-immolateur, implanté par Dieu. Cet instinct était beaucoup plus puissant que les faibles efforts des hommes rationnels qui tâchaient d’obtenir la paix et le bonheur (ce qui n’était pas, en tout cas, le désir le plus profond du cœur humain, seulement celui de sa caricature – l’intelligence libérale), en organisant la vie de la société, sans tenir compte des forces violentes qui, tôt ou tard, feraient crouler leurs maigres structures tels des châteaux de cartes. Pour Maistre, le champ de bataille paraissait typique de la vie sous tous ses aspects, et il se moquait des généraux qui croyaient contrôler les mouvements de leurs troupes et diriger le cours du combat. (…)
Mais le parallèle est encore plus profond. Le comte savoyard et le comte russe réagissent tous les deux, et violemment, contre l’optimisme libéral confiant en la bonté humaine, la raison humaine, et la valeur ou le caractère inévitable du progrès matériel : tous les deux condamnent totalement la notion que des moyens scientifiques et rationnels peuvent rendre l’humanité éternellement heureuse et vertueuse. (…)
Maistre et Tolstoï parlèrent tous deux avec la même ironie méprisante des réformateurs politiques. (…) Ils n’ont tous deux que du mépris et de l’hostilité envers les intellectuels. Maistre les considère non seulement comme des victimes grotesques du processus historique – des personnages hideux créés par la Providence pour forcer l’humanité, par la peur, à retourner à l’ancienne foi romaine – mais aussi des êtres dangereux pour la société, une secte malfaisante d’inquisiteurs, de corrupteurs de la jeunesse, contre qui tout chef d’État avisé doit sévir. Tolstoï les traite avec mépris plutôt que haine, et les représente comme de pauvres créatures sans jugement, des faibles d’esprit avec des illusions de grandeur. Maistre, lui, les tient pour un fléau social et politique, une plaie au cœur de la civilisation chrétienne, qui est la plus sacrée, et ne sera préservée que par les efforts héroïques du Pape et de son Église. Pour Tolstoï, ce sont d’adroits imbéciles débitant des subtilités vides, sourds et aveugles devant les réalités que des cœurs plus simples peuvent comprendre ; et de temps en temps, il s’attaque à eux avec la violence brutale du vieux paysan farouche et anarchique qui se venge, après des années de silence, sur ces singes stupides, urbains, bavards, sûrs d’eux, si pleins de paroles pour tout expliquer, suffisants, impuissants et creux. Tous deux rejettent toute interprétation de l’Histoire qui ne place pas en premier lieu le problème du pouvoir, et parlent avec mépris des tentatives d’explication rationnelle de sa nature. (…)
Bien que Maistre fût un ultramontain fanatique et partisan des institutions établies, tandis que Tolstoï, apolitique dans ses premières œuvres, ne faisait preuve d’aucun sentiment radical, tous les deux donnaient obscurément l’impression d’être nihilistes : les valeurs humanitaires du XIXe siècle se désintégraient dans leurs mains. Tous deux ont cherché, comme échappatoire à leur scepticisme inéluctable et insoluble, une sorte de grande vérité invincible qui les protégerait des effets de leur propre tempérament, de leurs inclinations naturelles ; Maistre dans l’Église, Tolstoï dans le cœur humain non corrompu et dans le simple amour fraternel – un état qu’il n’a pu connaître que rarement, un idéal devant lequel tout son talent descriptif le quitte et donne d’habitude quelque chose de peu artistique, de raide, de naïf, de très touchant, mais invraisemblable, et manifestement éloigné de sa propre expérience.
Cependant, l’analogie ne doit pas être trop soulignée : il est vrai que Maistre et Tolstoï attachent tous deux la plus grande importance à la guerre et aux conflits, mais Maistre, comme après lui Proudhon, glorifie la guerre, la juge mystérieuse et divine, tandis que Tolstoï la hait et ne la considérerait en principe inexplicable que si nous connaissions une quantité suffisante des nombreuses causes minimes – la fameuse « différentielle » de l’Histoire. (…) (pages 118-135)
En pratique, la sagesse est surtout la notion de l’inévitable : de ce qui doit arriver, étant donné l’ordre de notre monde ; et réciproquement, comment certaines choses ne peuvent pas, ou n’auraient pas pu être faites ; comment certains projets doivent, inévitablement, finir par un échec, bien que l’on ne puisse en donner aucune raison démontrable ou scientifique. Le don rare de s’en rendre compte, nous l’appelons à juste titre le « sens de la réalité » : c’est le sens de ce qui est compatible et de ce qui est incompatible, de ce qui peut ou non coexister, et cela a plusieurs noms : perspicacité, sagesse, esprit pratique, sens du passé, compréhension de la vie et du caractère humain.Voir également Le sens des réalités, d’Isaiah Berlin
Tolstoï lui-même sait aussi que la vérité est « là » et pas « ici » – pas dans les domaines accessibles à l’observation, au discernement, à l’imagination constructive, pas dans le pouvoir de la perception et de l’analyse microscopiques, dont il est sans aucun doute le plus grand maître de notre temps. Mais il n’a pas réussi à la voir face à face. Car il n’a pas, malgré ses efforts, une vision de l’ensemble. Il n’est pas, il est loin d’être, un hérisson ; et ce qu’il voit, avec une minutie croissante, ce n’est pas l’unité, mais toujours la pluralité, dans toute son individualité fertile, avec une lucidité pénétrante, obsessionnelle, inéluctable, incorruptible, et il en est exaspéré. (Page 149)
Mieux vaut, sûrement, ne pas prétendre calculer l’incalculable, ne pas prétendre qu’il y ait un point archimédien en dehors du monde à partir duquel tout est mesurable et modifiable ; mieux vaut employer dans chaque contexte les méthodes qui paraissent lui convenir le mieux, celles qui donnent (pragmatiquement) le meilleur résultat ; résister aux tentations de Procuste. Mieux vaut, surtout, séparer ce qui est isolable, susceptible d’être classé et d’être étudié objectivement, et quelquefois mesuré de façon précise et manipulé, le séparer des aspects les plus permanents, omniprésents, inéluctables et intimement présents de notre monde, qui nous sont plutôt trop familiers, faisant trop partie de nous-mêmes, si bien que leur pression, « inexorable », s’exerçant trop sur nous, est à peine ressentie, à peine remarquée par nous et ne peut d’aucune façon être observée en perspective, ou devenir un objet d’étude. C’est cette distinction-là qui pénètre la pensée de Pascal et de Blake, de Rousseau et Schelling, de Goethe et Coleridge, de Chateaubriand et Carlyle, de tous ceux qui parlent des raisons du cœur, ou de la nature morale ou spirituelle des hommes, ou du sublime et de la profondeur, de l’intuition « plus profonde » des poètes et des prophètes, de certaines façons particulières de comprendre le monde intérieurement, ou d’être en communion avec lui. Tolstoï et Maistre appartiennent à cette catégorie de penseurs. Tolstoï attribue tout à notre ignorance des causes empiriques, Maistre à l’abandon de la logique thomiste ou de la théologie de l’Église catholique. Mais ces professions de foi sont démenties par le ton et le contenu de ce que disent vraiment ces deux grands critiques. Tous deux insistent très souvent sur le contraste entre « intérieur » et « extérieur », entre la « surface », qui seule est éclairée par les rayons de la science et de la raison, et les « profondeurs » – la véritable vie vécue par les hommes. (page 160)
Traduit de l’anglais par Aline Berlin
Préface de Mario Vargas Llosa traduite de l’espagnol par Albert Bensoussan et Daniel Lefort
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/re-decouvrir-isaiah-berlin-penseur-de-la-liberte-859807.html
Dans "Le hérisson et le renard" (*), le philosophe Isaiah Berlin, l'auteur du célèbre "Eloge de la liberté", s'interroge en relisant l'œuvre de Tolstoï sur les causes de la destinée humaine à partir d'un vers d'un poète grec : « Le renard sait beaucoup de choses, le hérisson n'en sait qu'une seule, mais grande ! » Pour le professeur de Oxford, plutôt hérisson, la liberté est une valeur fondamentale au milieu d'un pluralisme irréductible de valeurs.
Par Cécile Philippe, économiste, Institut économique Molinari
La maison d'édition les Belles-Lettres vient de publier la traduction en français d'un essai du philosophe Isaiah Berlin. Il y commente la théorie de l'histoire de l'écrivain russe Léon Tolstoï. Il n'y a pas meilleur moment pour se précipiter sur ce petit ouvrage car, en cette période compliquée, quel bonheur de se retrouver en si bonne compagnie ! L'auteur explore avec originalité et tendresse la personnalité du célèbre auteur de Guerre et Paix. En prime, l'ouvrage nous offre une préface lumineuse de Mario Vargas Llosa, lauréat du prix Nobel de littérature en 2010.
Comme d'autres figures de l'histoire, Léon Tolstoï avait capturé l'imagination d'Isaiah Berlin en ce qu'il représentait, pour lui, l'exemple triomphant d'un observateur de la vie, gardant une distance nécessaire à cette observation et, pour autant, capable aussi de s'y plonger entièrement et pleinement. Isaiah Berlin en fera, d'ailleurs, sa marque de fabrique : s'immerger dans les écrits des auteurs qui le fascinaient afin de mener sa propre recherche philosophique au cœur de l'histoire des valeurs humaines.
Si Tolstoï participe de cette recherche, c'est parce qu'il est l'exemple typique d'une âme tourmentée, divisée entre ce qu'il ne peut s'empêcher d'être et l'idéal de ce qu'il aurait voulu être. C'est afin de cerner cette caractéristique chez Tolstoï que Berlin introduit la différence entre le hérisson et le renard, titre de son essai.
Division entre renards et hérissons
Cette différence, il la découvre juste avant la Seconde guerre mondiale, dans un vers du poète grec Archiloque : « Le renard sait beaucoup de choses, le hérisson n'en sait qu'une seule, mais grande ! ». Berlin s'amusa alors à diviser les grands auteurs entre renards et hérissons. Goethe serait un renard, tandis que Dostoïevski et Tolstoï seraient des hérissons. En 1951, alors qu'il travaille sur Léon Tolstoï et sa théorie de l'histoire (que l'on trouve notamment dans ses romans), Berlin recourt à cette métaphore. Elle lui permet de détecter un aspect fondamental de la personnalité de Tolstoï, sa vision, point focal à côté duquel sont passés la plupart de ses contemporains et critiques.
Car si Léon Tolstoï était un renard inégalé du fait de sa capacité à saisir et décrire avec finesse « l'expérience réelle d'hommes et de femmes réels dans leurs relations les uns avec les autres », il aspirait - nous dit Berlin - à être un hérisson, capable de rapporter « tout à une vision centrale ; à un seul système [...], un principe organisateur, unique et universel ».
C'est dans le cadre de cette recherche quasi obsessionnelle qu'il faut lire Guerre et Paix. On peut y trouver le dilemme moral de ce renard à la recherche de réponses aux « problèmes fondamentaux : problème du bien et du mal, de l'origine et du but de l'univers et de ses habitants, des causes de tout ce qui a lieu. »
Toute sa vie, Tolstoï aspirera, sans succès, nous dit Berlin à trouver les causes réelles des choses et des êtres. D'où son intérêt immense pour l'Histoire, les nombreuses incursions historiques dans ses romans et au final ses profondes désillusions à ce sujet. Incapable d'abandonner son côté renard - cette croyance profonde que ce sont « les faits intérieurs qui, dans l'expérience des êtres humains, sont les plus réels et les plus immédiats ; ce sont eux, et eux seuls qui, en dernier ressort, constituent la vie » -, il ne parviendra jamais à satisfaire son idéal hérisson soucieux de savoir quelle est la puissance qui conduit la destinée des peuples.
Isaiah Berlin ose dans le cadre de son essai une comparaison avec l'auteur français savoyard Joseph de Maistre, chez qui il a décerné le même dilemme. Si les deux auteurs s'opposaient radicalement en ce que l'un était « apôtre de l'Evangile qui prêche la fraternité entre les hommes, l'autre, le froid défenseur des droits de la violence, du sacrifice aveugle, et de la souffrance éternelle », les deux étaient unis par l'impossibilité d'échapper au même tragique paradoxe : « c'étaient des observateurs qui ne pouvaient aucunement être abusés par [...] les systèmes unificateurs, les croyances et les sciences, qui servaient aux êtres superficiels ou désespérés à se dissimuler les chaos et à le dissimuler aux autres. Tous deux étaient à la recherche d'un univers harmonieux, mais ne trouvaient partout que guerres et désordre. »
L'écrivain Mario Vargas Llosa, qui nous gratifie d'une préface utile à l'essai d'Isaiah Berlin, ne semble pas être un hérisson. En renard assumé, il affirme que le progrès véritable « a toujours été atteint grâce à une application partiale hétérodoxe et déformée des théories sociales. Des théories sociales au pluriel, ce qui veut dire que des systèmes idéologiques différents, parfois inconciliables, ont déterminé des progrès identiques ou semblables. » Adepte de la raison pratique, il propose de s'accommoder des contradictions inhérentes au monde tel que nous le vivons.
Le compromis politique comme moyen de résolution pacifique
Que conclure sur le philosophe Isaiah Berlin, lui-même ? Pour son biographe Michael Ignatieff, Isaiah Berlin était un hérisson qui voyait la liberté comme une valeur fondamentale au milieu d'un pluralisme irréductible de valeurs. A l'origine de conflits inévitables, Berlin voyait le compromis politique comme un moyen nécessaire de leur résolution pacifique.
Ce pluralisme a parfois valu à Isaiah Berlin d'être accusé de relativisme, probablement sans réel fondement. A l'image de cette distinction entre renard et hérisson qui a traversé les âges depuis plus de 2500 ans, il voyait un horizon commun à toute l'espèce humaine et le moyen d'évaluer les cultures selon certains standards ultimes. Reste que la diversité, y compris morale, était aussi, pour lui, une constante de l'humanité. Selon lui, seule l'arrogance rationaliste a pu la mettre sur le compte de l'ignorance ou de la superstition. De telles différences se doivent d'être respectées et protégées, comme il a essayé de les reconnaitre dans cet essai sur les ambivalences et les ambiguïtés de Léon Tolstoï.
________
(*) Isaiah Berlin Le Hérisson et le Renard : essai sur la vision de l'Histoire de Tolstoï, Les Belles Lettres, 2020, 140 pages,
Par Cécile Philippe, économiste, Institut économique Molinari
La maison d'édition les Belles-Lettres vient de publier la traduction en français d'un essai du philosophe Isaiah Berlin. Il y commente la théorie de l'histoire de l'écrivain russe Léon Tolstoï. Il n'y a pas meilleur moment pour se précipiter sur ce petit ouvrage car, en cette période compliquée, quel bonheur de se retrouver en si bonne compagnie ! L'auteur explore avec originalité et tendresse la personnalité du célèbre auteur de Guerre et Paix. En prime, l'ouvrage nous offre une préface lumineuse de Mario Vargas Llosa, lauréat du prix Nobel de littérature en 2010.
Comme d'autres figures de l'histoire, Léon Tolstoï avait capturé l'imagination d'Isaiah Berlin en ce qu'il représentait, pour lui, l'exemple triomphant d'un observateur de la vie, gardant une distance nécessaire à cette observation et, pour autant, capable aussi de s'y plonger entièrement et pleinement. Isaiah Berlin en fera, d'ailleurs, sa marque de fabrique : s'immerger dans les écrits des auteurs qui le fascinaient afin de mener sa propre recherche philosophique au cœur de l'histoire des valeurs humaines.
Si Tolstoï participe de cette recherche, c'est parce qu'il est l'exemple typique d'une âme tourmentée, divisée entre ce qu'il ne peut s'empêcher d'être et l'idéal de ce qu'il aurait voulu être. C'est afin de cerner cette caractéristique chez Tolstoï que Berlin introduit la différence entre le hérisson et le renard, titre de son essai.
Division entre renards et hérissons
Cette différence, il la découvre juste avant la Seconde guerre mondiale, dans un vers du poète grec Archiloque : « Le renard sait beaucoup de choses, le hérisson n'en sait qu'une seule, mais grande ! ». Berlin s'amusa alors à diviser les grands auteurs entre renards et hérissons. Goethe serait un renard, tandis que Dostoïevski et Tolstoï seraient des hérissons. En 1951, alors qu'il travaille sur Léon Tolstoï et sa théorie de l'histoire (que l'on trouve notamment dans ses romans), Berlin recourt à cette métaphore. Elle lui permet de détecter un aspect fondamental de la personnalité de Tolstoï, sa vision, point focal à côté duquel sont passés la plupart de ses contemporains et critiques.
Car si Léon Tolstoï était un renard inégalé du fait de sa capacité à saisir et décrire avec finesse « l'expérience réelle d'hommes et de femmes réels dans leurs relations les uns avec les autres », il aspirait - nous dit Berlin - à être un hérisson, capable de rapporter « tout à une vision centrale ; à un seul système [...], un principe organisateur, unique et universel ».
C'est dans le cadre de cette recherche quasi obsessionnelle qu'il faut lire Guerre et Paix. On peut y trouver le dilemme moral de ce renard à la recherche de réponses aux « problèmes fondamentaux : problème du bien et du mal, de l'origine et du but de l'univers et de ses habitants, des causes de tout ce qui a lieu. »
Toute sa vie, Tolstoï aspirera, sans succès, nous dit Berlin à trouver les causes réelles des choses et des êtres. D'où son intérêt immense pour l'Histoire, les nombreuses incursions historiques dans ses romans et au final ses profondes désillusions à ce sujet. Incapable d'abandonner son côté renard - cette croyance profonde que ce sont « les faits intérieurs qui, dans l'expérience des êtres humains, sont les plus réels et les plus immédiats ; ce sont eux, et eux seuls qui, en dernier ressort, constituent la vie » -, il ne parviendra jamais à satisfaire son idéal hérisson soucieux de savoir quelle est la puissance qui conduit la destinée des peuples.
Isaiah Berlin ose dans le cadre de son essai une comparaison avec l'auteur français savoyard Joseph de Maistre, chez qui il a décerné le même dilemme. Si les deux auteurs s'opposaient radicalement en ce que l'un était « apôtre de l'Evangile qui prêche la fraternité entre les hommes, l'autre, le froid défenseur des droits de la violence, du sacrifice aveugle, et de la souffrance éternelle », les deux étaient unis par l'impossibilité d'échapper au même tragique paradoxe : « c'étaient des observateurs qui ne pouvaient aucunement être abusés par [...] les systèmes unificateurs, les croyances et les sciences, qui servaient aux êtres superficiels ou désespérés à se dissimuler les chaos et à le dissimuler aux autres. Tous deux étaient à la recherche d'un univers harmonieux, mais ne trouvaient partout que guerres et désordre. »
L'écrivain Mario Vargas Llosa, qui nous gratifie d'une préface utile à l'essai d'Isaiah Berlin, ne semble pas être un hérisson. En renard assumé, il affirme que le progrès véritable « a toujours été atteint grâce à une application partiale hétérodoxe et déformée des théories sociales. Des théories sociales au pluriel, ce qui veut dire que des systèmes idéologiques différents, parfois inconciliables, ont déterminé des progrès identiques ou semblables. » Adepte de la raison pratique, il propose de s'accommoder des contradictions inhérentes au monde tel que nous le vivons.
Le compromis politique comme moyen de résolution pacifique
Que conclure sur le philosophe Isaiah Berlin, lui-même ? Pour son biographe Michael Ignatieff, Isaiah Berlin était un hérisson qui voyait la liberté comme une valeur fondamentale au milieu d'un pluralisme irréductible de valeurs. A l'origine de conflits inévitables, Berlin voyait le compromis politique comme un moyen nécessaire de leur résolution pacifique.
Ce pluralisme a parfois valu à Isaiah Berlin d'être accusé de relativisme, probablement sans réel fondement. A l'image de cette distinction entre renard et hérisson qui a traversé les âges depuis plus de 2500 ans, il voyait un horizon commun à toute l'espèce humaine et le moyen d'évaluer les cultures selon certains standards ultimes. Reste que la diversité, y compris morale, était aussi, pour lui, une constante de l'humanité. Selon lui, seule l'arrogance rationaliste a pu la mettre sur le compte de l'ignorance ou de la superstition. De telles différences se doivent d'être respectées et protégées, comme il a essayé de les reconnaitre dans cet essai sur les ambivalences et les ambiguïtés de Léon Tolstoï.
________
(*) Isaiah Berlin Le Hérisson et le Renard : essai sur la vision de l'Histoire de Tolstoï, Les Belles Lettres, 2020, 140 pages,
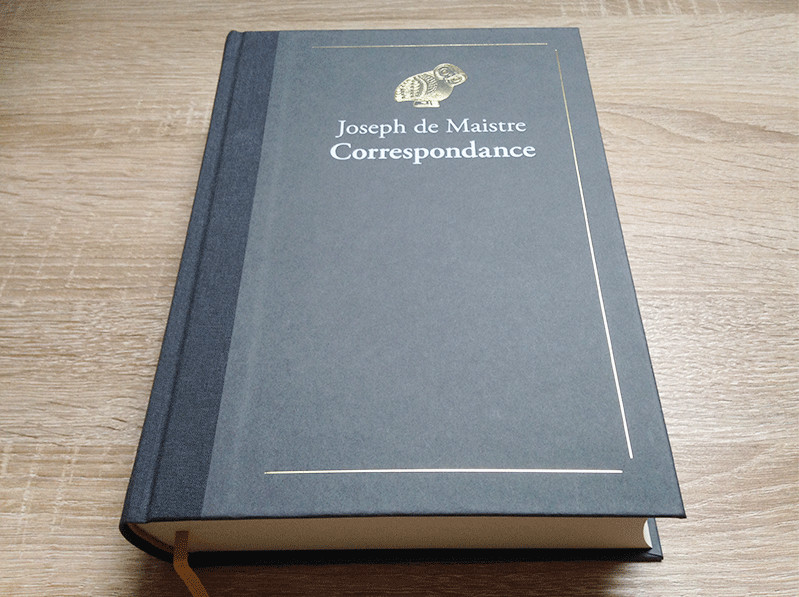

 Accueil
Accueil











